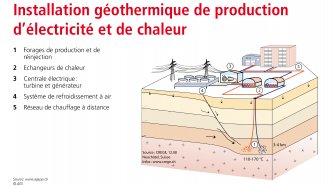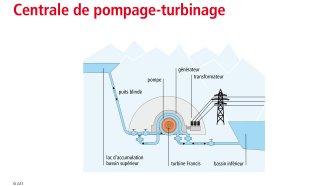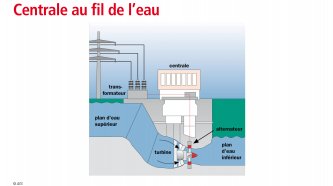Photos
Thème
Type
Etude Les trois voies de l’étude «Scénarios pour l’approvisionnement électrique du futur» - Encart
Documents
Une comparaison des prélèvements obligatoires imposés aux producteurs d’hydroélectricité dans sept pays d’Europe montre de grandes différences – au détriment des producteurs suisses.
Etude (an allemand) - Angebot und Nachfrage nach flexiblen Erzeugungskapazitäten in der Schweiz
Photos
Photos
Documents